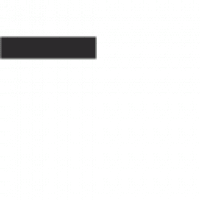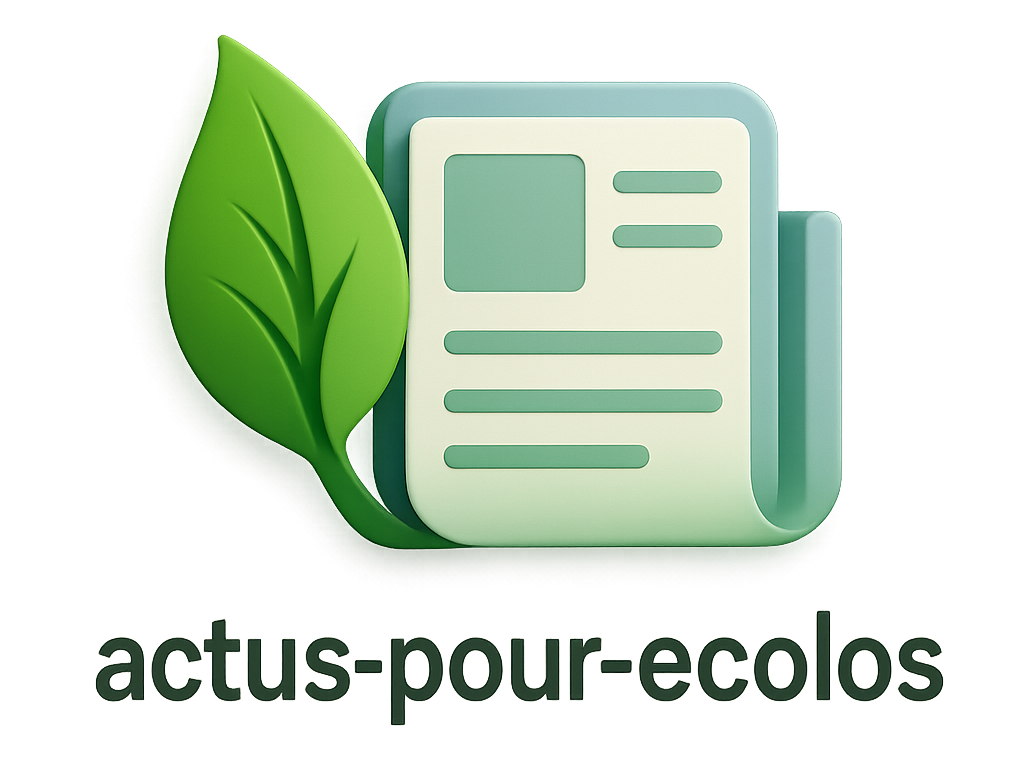Gaz et charbon : enjeux et perspectives dans la transition énergétique mondiale
Alors que la planète fait face à une urgence climatique sans précédent, la transition énergétique s’impose comme un impératif global. En 2025, la diminution progressive du charbon et la gestion prudente du gaz naturel sont au cœur des stratégies pour réduire les émissions de CO₂ tout en assurant la sécurité énergétique. En France, seules deux centrales à charbon restent en activité, témoignant d’une volonté politique forte de sortir des énergies fossiles les plus polluantes, selon le site spécialisé ekwateur. Pourtant, la transition vers un mix énergétique plus propre se heurte à des défis techniques, économiques et sociaux majeurs, nécessitant des solutions équilibrées et innovantes pour concilier décarbonation et stabilité du réseau.
La transition énergétique : un impératif mondial
La transition énergétique consiste à passer d’un système basé sur les énergies fossiles — pétrole, charbon, gaz — à un modèle privilégiant les énergies renouvelables et bas carbone, tout en améliorant l’efficacité énergétique. Cette mutation est devenue indispensable en 2025, alors que la concentration de gaz à effet de serre atteint des niveaux critiques, accentuant le dérèglement climatique. Par ailleurs, la sécurité énergétique des États est fragilisée par la volatilité des marchés des énergies fossiles, ce qui rend la transition d’autant plus urgente.
La combustion des énergies fossiles est responsable d’environ 75 % des émissions mondiales de CO₂, contribuant fortement à la pollution, au réchauffement climatique et à la dégradation des écosystèmes. Réduire cette dépendance est donc une priorité pour limiter les impacts environnementaux et préserver la biodiversité.
La situation en France : vers la fin du charbon
La France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Dans ce cadre, le pays a drastiquement réduit sa dépendance au charbon, ne conservant en 2025 que deux centrales à charbon en activité, situées à Saint-Avold et Cordemais. Ces installations fonctionnent désormais de manière marginale, principalement pour sécuriser l’approvisionnement lors des pics de demande ou en cas de défaillance du parc nucléaire.
La centrale de Saint-Avold, réactivée en 2022 dans un contexte de crise énergétique, doit cesser son activité définitive d’ici 2027. Un projet de reconversion partielle vers le gaz enrichi en biométhane est en cours, illustrant la volonté d’intégrer des solutions plus durables. À Cordemais, la fermeture programmée s’accompagne d’une reconversion industrielle vers la fabrication de composants pour le nucléaire, témoignant d’une stratégie de transition industrielle réfléchie.
Le rôle du gaz naturel : une énergie de transition délicate
Le gaz naturel est souvent présenté comme un « pont » vers la décarbonation, car il émet moins de CO₂ que le charbon lors de sa combustion. Il joue un rôle clé pour assurer la stabilité des réseaux électriques, notamment en compensant l’intermittence des énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien. En France, le gaz reste donc une composante importante du mix énergétique, même si son usage doit être strictement encadré pour éviter un effet de verrouillage technologique et une dépendance prolongée aux hydrocarbures.
Les énergies renouvelables en plein essor
Le remplacement du charbon s’appuie sur le développement massif des énergies renouvelables — solaire, éolien, hydraulique, biomasse — ainsi que sur l’électrification des usages, notamment dans les transports et le chauffage. La France vise à atteindre 33 % d’énergies renouvelables dans son mix électrique d’ici 2030. Cette dynamique s’inscrit dans une tendance mondiale où la production d’électricité renouvelable devrait dépasser celle du charbon d’ici 2025, selon l’Agence internationale de l’énergie.
Cependant, l’intermittence de ces sources impose de repenser la flexibilité du réseau électrique et de développer des solutions de stockage performantes. Les innovations technologiques, telles que l’hydrogène vert, le biogaz, le stockage longue durée et l’intelligence artificielle appliquée à la gestion des réseaux, sont des pistes prometteuses pour accélérer la décarbonation sans compromettre la sécurité d’approvisionnement.
Un contexte mondial contrasté
À l’échelle mondiale, la situation est contrastée. Si l’Europe accélère sa sortie du charbon, d’autres régions, notamment en Asie, continuent d’augmenter leurs capacités charbonnières, freinant la baisse globale des émissions. En 2024, la demande mondiale de charbon a atteint un niveau record, notamment en Chine, qui a mis en service une importante capacité de production d’électricité au charbon. Cette réalité souligne les défis persistants de la transition énergétique, en particulier dans les économies émergentes.
Enjeux économiques et sociaux
La transition énergétique implique des transformations industrielles majeures, avec la fermeture progressive des centrales à charbon et la réduction du gaz naturel. Ces changements nécessitent des investissements massifs dans les infrastructures, ainsi qu’un accompagnement des territoires et des travailleurs concernés pour assurer une reconversion juste et efficace.
Par ailleurs, la volatilité des prix de l’énergie et la hausse des coûts soulignent la nécessité de garantir un accès à une électricité abordable et fiable pour tous, afin d’éviter des tensions sociales et économiques.
Perspectives d’experts
Les spécialistes insistent sur la complexité de cette mutation. Réussir la transition énergétique, c’est garantir un avenir viable pour les générations futures, en combinant sobriété, efficacité énergétique, développement des renouvelables et innovation technologique. Selon les analyses récentes, un équilibre entre réduction des énergies fossiles, développement des alternatives propres et maintien de la sécurité d’approvisionnement est indispensable pour relever ce défi multidimensionnel.
Les avancées en France et en Europe montrent qu’il est possible de concilier ambition climatique et sécurité énergétique, à condition d’accompagner les mutations industrielles, d’investir dans l’innovation et de maintenir un dialogue social constructif. Le chemin reste long, mais les orientations prises aujourd’hui dessinent les contours d’un système énergétique plus durable et résilient.